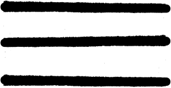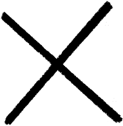Dirigé depuis 2023 par Claire Dupont, le Théâtre de la Bastille a la puissance de certains lieux, rares, dépositaires de multiples mémoires : celles des spectateurices, celles des artistes, des équipes administratives et techniques qui ont traversé les saisons.
Les murs du 76 rue de la Roquette ont d’ailleurs de nombreuses histoires à raconter. D’abord une manufacture, le lieu fût transformé en petit théâtre de variété puis, en 1912, en salle de cinéma. Avant de redevenir un théâtre en 1974, changeant son nom à plusieurs reprises, passant du théâtre Oblique au théâtre de la Roquette, avant de devenir le Théâtre de la Bastille. Il fut dirigé par Jean-Claude Fall (1982-1988) puis par Jean-Marie Hordé (1989-2022), accompagné notamment à la programmation par Jean-Marc Adolphe, Marc Sussi, Olivier Bertrand et Géraldine Chaillou.
S’affirmant comme un lieu singulier de la création contemporaine, l’identité de ce théâtre fut écrite par Tiago Rodrigues, Nathalie Béasse, le tg STAN, l’Avantage du doute, le Raoul Collectif, Pauline Bayle, Amir Reza Koohestani, Lisbeth Gruwez, Jan Lauwers, Alain Platel, Raimund Hoghe, Gisèle Vienne, Pierre Meunier, Les Possédés ou encore Gwenaël Morin.
Depuis 2023, cette histoire continue de s’inventer, toujours avec impertinence, toujours aux aguets, affirmant plus fortement l’accompagnement et la présence des artistes, à travers notamment la réunion un Parlement artistique, composé aujourd’hui de Gurshad Shaheman, Betty Tchomanga, Agnés Mateus et Quim Tarrida. Ce Parlement affirme la nécessité d’entrecroiser des écritures puissantes, qui tiennent un propos particulier sur le monde, reliant le travail des artistes aux grandes questions qui chahutent notre société.
Chacun son tour, ces artistes sont invité·e·s à développer un fil rouge à partir d’une création, comme un Écho du monde, qui éditorialise la saison dont ils sont le pilote. Au fil de débats, d’ateliers, de projections et de créations participatives, le Théâtre de la Bastille se rêve comme le lieu d’une réflexion collective, capable d’accueillir une pluralité d’interprétations, désireuse d’abriter des histoires diverses, sans jamais renoncer aux frottements et aux contractions.
La découverte des nouvelles dramaturgies du bassin méditerranéen est un autre cœur vivant de la programmation. A une époque où les frontières se ferment et les murs se dressent, le Théâtre de la Bastille travaille à une circulation des formes esthétiques et des artistes, notamment des jeunes créatrices.
Avec ses deux salles de 261 et de 155 places, le Théâtre de la Bastille continue d’assumer un rôle de passeur, d’une œuvre envers des publics, de l’inconnu à la notoriété, de l’alternative à l’institution. Pour ce faire, il défend des exploitations longues, en cession, et s’engage en production auprès des compagnies. Le Théâtre de la Bastille se donne ainsi pour mission de soutenir au mieux le cycle de vie des spectacles et des artistes, de l’émergence jusqu’à la reconnaissance publique et institutionnelle. En collaboration avec l’office de production Prémisses, il accompagnera notamment des artistes émergents sur trois ans.
Et parce qu’habiter un théâtre, c’est aussi arpenter le territoire qui l’entoure, le Théâtre de la Bastille construit chaque saison un programme de spectacles joués hors-les-murs, d’abord dans le 11e arrondissement, s’aventurant bientôt au-delà.
En 2022, le Théâtre a changé de statut. L’État et la Ville de Paris lui ont renouvelé leur soutien et ont souhaité qu’il sorte de son statut hybride pour devenir pleinement un théâtre public. Une association est donc créée en 2022, dont le bureau est composé de Catherine Dan (Présidente), André Mondy (Trésorier) et Claire Delcroix (Secrétaire générale).