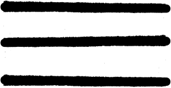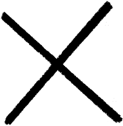Laure Dautzenberg : Comment est née l’idée de ce spectacle ?
Gabriel Sparti : L’idée est venue de mon départ de Suisse pour la Belgique. En accédant à une distance par rapport à mon milieu, j’ai pu commencer à y réfléchir. Avec les allers-retours entre les deux pays, une sorte de montage de paysages se faisait dans ma tête. J’étais à Liège, je voyais la Meuse, les gens, les bars, la ville et je revenais en Suisse, et je voyais le lac, les montagnes. Cela peut paraître cliché mais ça ne l’est pas tant que ça. Le paysage peut être mis au service d’un projet patriotique : en Suisse on s’identifie aux vallées protégées par les montagnes, en Angleterre à la mer… C’est un type de rapport au patriotisme qui diffère de l’identification à la Révolution – en France notamment, ce qu’Elias Canetti a bien étudié. Il y a donc cette importance du paysage, mais qui, chez moi, se teinte d’inquiétude, et surtout d’un rapport que je trouve inquiétant entre les gens et le paysage. Pendant une rencontre autour du théâtre suisse à la Comédie de Genève, Séverine Chavrier évoquait une phrase de Thomas Bernhard, qui dit qu’un paysage est tout sauf anodin, qu’il peut même effriter le cerveau... Donc commencer à être en rapport différemment à ce paysage m’a petit à petit donné envie d’en faire du théâtre pour voir comment pouvait se traduire ce lien, et comment celui-ci amenait à réfléchir au milieu dans lequel on vit, puis à la nation, puis à l’idée de la nation... Je suis alors vraiment parti sur l’idée de travailler « la Suisse », d’en faire un matériau. Même si celui-ci part du cliché et d’une chose extrêmement spécifique, je voulais voir comment il pouvait exprimer davantage que cette spécificité-là. Car pour moi, Heimweh / Mal du pays parle aussi d’une certaine partie de l’Europe.
À partir de ce point de départ, on a creusé deux espaces de recherche. D’une part qu’est-ce qu’un étranger qui découvre les bords du lac, question pour laquelle nous nous sommes inspirés de Robert Walser et de Dostoïevski. D’autre part que peuvent créer théâtralement des corps suisses entrant sur un plateau de théâtre ? Pour cette partie, l’inspiration a plutôt été Mars de Fritz Zorn1 : nous avons cherché à traduire théâtralement son récit de la Suisse comme créatrice de cancer, à travers un regard, un geste, un petit dialogue, une certaine attitude par rapport à la représentation. L’autre inspiration a été Anne Dufourmantelle2 et sa réflexion sur la douceur et sur sa face sombre : comment celle-ci peut venir travailler à des endroits de violence et de perversion.
L.D. : Il y a une place importante donnée au chant. Pourquoi lui avoir octroyé cette place-là ?
G.S. : La question musicale a été présente immédiatement. Le patrimoine et le folklore y sont très vite associés. Il suffit de penser aux hymnes... Quand on installe de la musique, on prend le pouvoir. Je voulais donc explorer ce que cette musique-là raconte du pays ou ce qu’elle permet de mettre en place pour que les habitants et les habitantes se racontent le pays d’une certaine manière.
Pour le tout premier chant, je désirais vraiment que ce soit comme une naissance. C’est donc un chant à une voix, très doux, qui vient d’extrêmement loin, comme la métaphore du souvenir d’une nation ou d’un appel au-delà de la montagne. J’ai commencé à dessiner le plateau avec cela.
Ensuite il y a Le Ranz des vaches, qui appartient vraiment au folklore. C’est un tube qui rassemble des milliers de personnes et des centaines de choristes lors d’une fête qui a lieu une fois tous les 25 ans dans la ville dans laquelle j’ai en partie grandi. Nous l’utilisons en rupture radicale avec l’esprit assez orgiaque de cette célébration où il y a énormément de monde, énormément d’effets. Ici, on a juste trois personnages, un décor plutôt pourri... Et ce chant, qui habituellement appelle les vaches, se transforme ici en appel des Suisses.
Pour les autres chants, il s’agit plutôt de voir comment ceux-ci amènent des outils dramaturgiques aux acteurs. Le Gai Printemps est ainsi un refuge, qui consiste à chanter pour ne pas parler, pour disparaître, pour éviter, pour vider la pensée ; un chant sur lequel on se repose, qui fait masse, crée un choeur, et ramène à une sorte d’atavisme politiquement dangereux. Le dernier chant est clairement nationaliste, mais il est entonné par les personnages qui se demandent pourquoi ils sont en train de chanter ça...
L.D. : La gêne, le malaise, l’encombrement, sont les sentiments qui dominent dans ce spectacle…
G.S. : La question d’origine étant « que se passe-t-il si un Suisse rentre sur un plateau ? ». On s’est rendu rapidement compte qu’on était alors face à des personnages qui n’ont pas du tout l’habitude d’être en public, de prendre de la place. Ils ont peur, c’est la première fois qu’ils sont à vue à ce point-là. Mais ils ne veulent pas montrer qu’ils ont peur, donc ils essaient d’apparaître comme ce qu’ils ne sont pas. Ils veulent bien faire, c’est-à-dire qu’ils veulent faire croire qu’ils ont la volonté de répondre aux questions, d’être en bonne entente avec le public. Mais profondément ils ne veulent pas du tout cela, ils veulent absolument éviter tout ce qui pourrait les mettre en danger, les remettre en cause. Tout cela génère du malaise. Et plus la pièce avance, plus les « Suisses » se sentent à l’aise entre eux, beaucoup moins quand ils font face à la situation réelle. Ils préfèrent le déni, l’évitement, la fuite, l’illusion à la réalité. Cela crée aussi un malaise théâtral parce qu’ils ne proposent pas de théâtre à part celui de l’enfermement, du repli sur soi, de la perversion, mais tout en jouant la gentillesse, la politesse, etc. On a toujours l’espoir que quelque chose se produise mais cet espoir est continuellement déjoué, il ne se produit que des non-événements, on se retrouve toujours face à une platitude.
L.D. : L’étranger les met tout de même dans un dispositif de rencontre très contraignant. Cela peut faire penser à un casting ou à un entretien d’embauche, un cadre dans lequel on n’a pas forcément envie d’être...
G.S. : Cette situation ne va pas, ne fonctionne pas. C’est assez clair très rapidement. Le personnage de l’Étranger est double. Il fait comme si tout allait bien mais il a préparé ses cartouches. Si l’entretien ne va pas, pour ces Suisses, c’est que cela ne se fait pas de poser des questions comme ça face à un public. Sauf qu’il n’est pas non plus possible pour eux de rejeter ce cadre : ils sont trop policés, trop conformistes…. Car le conformisme pour moi, c’est de se dire « bon, ça ne va pas, mais on le fait quand même, on essaie de survivre là-dedans, on ne va pas transformer la situation, mais de l’intérieur, on va user du déni, de l’évitement, de la fuite, pour faire en sorte de tenir une situation qu’on ne rencontre pas, pour faire illusion... » Et ces corps conformistes nous racontent nous aussi, quand on attend, quand on observe, en espérant qu’il se passe quelque chose mais en ne faisant rien d’autre que le dire. Politiquement, je trouve que cela raconte quelque chose.
L.D. : Vous avez cité Fritz Zorn et Mars. On pense aussi évidemment à Thomas Bernhard, dont vous adaptez d’ailleurs une lettre antipatriotique dans le spectacle. Mais c’est beaucoup plus doux que ce que peut écrire Bernhard...
G.S. : Le point de départ n’est pas le même. Avec Bernhard on est vraiment sur la haine de soi, la haine de ce à quoi on appartient, qui est aussi dans Heimweh / Mal du pays. Sauf qu’ici, elle se double d’une forme de mélancolie,certaines choses par rapport à ce pays, sa politique, ces moeurs, qui se sont révélées être des sortes de fictions. Il s’agit moins d’une haine pure que d’une forme de conscience malheureuse, de mélancolie, liée à cette illusion perdue et à une colère de ne pas l’avoir vu avant. Ou de s’être fait avoir : le monde n’est pas comme on a voulu nous faire croire qu’il est. C’est un sentiment né à l’adolescence mais qui reste dans le travail, une prise de conscience à la fois heureuse et douloureuse.
L.D. : Il y a quelque chose de très désuet dans les costumes et la scénographie... Pourquoi ce choix ?
G.S. : Chaque personnage suisse a plusieurs costumes, et il y en a tout de même de plus modernes… Il s’agissait de travailler sur l’ennui : s’il y a originalité, que celle-ci soit absolument inconsistante… Pour le costume de l’Étranger, on est beaucoup plus sur l’archétype du personnage littéraire. On ne va pas copier Walser, mais nous souhaitions ce vieux personnage de théâtre qui apparaît dans un vieux décor et qui va chercher du nouveau là-dedans. Nous avions la volonté de travailler sur de la poussière...
L.D. : Il y a beaucoup d’humour. Est-ce que c’était quelque chose qui était là à l’origine, ou est-ce que c’est né au fur et à mesure ?
G.S : Au départ, ma volonté n’était pas de faire rire. Mais à un moment donné le rire est arrivé. Les situations d’évitement, leur malaise, ramènent quelque chose de comique, créent des tensions clownesques. On a eu des propositions où tout le monde était plié en deux, sans savoir forcément pourquoi. Cela m’intriguait et j’ai donc gardé ces propositions. Ensuite, petit à petit, je me suis dit OK, ça rit. Mais pourquoi est-ce que cela rit ? Comment ça rit ? Qu’est-ce que l’on veut créer comme rire ? On rit de quoi ? Est-ce qu’on se moque ? Est-ce que ça soulage ? Est-ce que c’est un rire cruel, un rire de défense, un rire gras ? Je pense qu’il y a plusieurs formes de rire dans le spectacle, il y a des bêtises, du rire cruel et du rire tendu, du rire gêné et du rire jaune. Donc j’ai eu envie de travailler tous ces rires, de redonner de la complexité à la question, d’aller chercher de la nuance dans cette gamme. Rire ne suffit pas, se satisfaire du rire non plus.
L.D. : Mais comment trouver cela et l’éprouver en répétition, sans public ?
G.S. : Je tiens au fait de travailler en public pour voir comment ça vit. Nous avons fait énormément de sorties de résidence et à chaque sortie de résidence, il y avait au moins 50 personnes. Je pense que cela a beaucoup aidé, a fortiori parce que nous l’avons joué à plusieurs endroits : en Suisse en Belgique, en France. Donc nous pouvions aussi travailler à différentes adresses et différentes réceptions : en France et en Belgique, la pièce a fait rire tout du long. En Suisse, ça rit, ça rit... ça rit un peu moins. Puis ça ne rit plus du tout – sauf peut-être une ou deux personnes. Et à la fin il y a un blanc.
L.D. : Le quatuor joue chaque soir avec de nouvelles identités improvisées, dîtes-vous. Qu’est ce qui change et pourquoi ?
G.S. : Il y a plusieurs moteurs là-dedans. D’abord, ce qu’ils disent est tellement ennuyeux, a tellement peu d’intérêt, que s’ils devaient redire le même texte chaque soir il y aurait de quoi se tirer une balle… Je cherche donc un type de jeu qui permette de retrouver, chaque soir, une énergie nouvelle en identifiant un objet inédit duquel se moquer. Mais il y a au-delà, un fond plus politique : prendre une nation toute entière pour cible, c’est aussi ne pas se contenter d’individus précis mais jouer au sein d’un ensemble de possibilités tout aussi douteuses les unes que les autres. Donc travailler à une forme d’improvisation, où tous les soirs on doit réinventer, permet de garder l’acteur, l’actrice vivante, de garder de l’étonnement, que ces personnages restent intéressés, intrigants, pour ensuite petit à petit les déplacer. Mais c’est tellement cadré, du point de vue de la forme et du langage, que même s’ils inventent chaque soir certaines informations, c’est au sein d’une qualité existentielle constante. C’est une question de dynamique de jeu.
1 Mars est un essai autobiographique dans lequel son auteur (Suisse) se livre à une critique acerbe de la société policée dans laquelle il a été élevé.
2 Puissance de la douceur, Payot Rivages