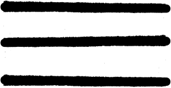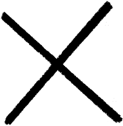Laure Dautzenberg : Vous avez fait un spectacle sur les violences policières, un autre sur les violences faites aux femmes, Patatas Fritas Falsas est un spectacle sur la violence politique, la violence d’État. Comment avez-vous construit ces trois pièces ?
Agnés Mateus : On a commencé à parler d’une trilogie comme d’une blague, puisque tout le monde fait des trilogies ! Puis on s’est dit pourquoi pas ? Et finalement, nous avons effectivement réalisé une trilogie sur la violence. Ici, il s’agit de violence politique, spécifiquement celle du fascisme et de l’extrême-droite qui se développent aussi parce que les autres partis permettent leur entrée au parlement, font des pactes avec eux, les écoutent... Lors de la première à Barcelone, nous ne l’avons cependant pas nommé directement. Nous avions un peu peur : on utilise le drapeau franquiste au début du spectacle, et en Espagne c’est un matériau très sensible. Beaucoup de symboles issus de la dictature persistent encore, sont encore dans nos vies. Or nous ne voulions pas attirer un certain type de gens. Nous ne faisons pas ce spectacle pour provoquer les fachos. Nous faisons ce spectacle pour tout le monde. Au bout de quelques jours, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de problème, alors on s’est senti plus à l’aise pour y aller frontalement.
L.D. : Vous évoquez une transition difficile. Mais l’Espagne a paru sortir très vite du franquisme et, même si Vox, le parti d’extrême-droite est aujourd’hui très fort, il y a un gouvernement de gauche…
A.M. : Oui, c’est vrai. Mais beaucoup de choses n’ont pas été traitées pendant la transition. Celle-ci a été très longue et très soft et a consisté en partie à dire « On va faire tout clean, on va tout oublier ». Les politiciens de cette époque-là sont restés pour beaucoup en activité ; on n’a pas jugé les crimes de la dictature, il y a eu une amnistie. Nous sommes des héritiers de ces années. Il a été considéré par beaucoup que la guerre civile avait été une guerre camp contre camp. Or ce n’est pas cela dont il s’agit : il y a eu un coup d’état contre lequel des gens se sont révoltés. C’est une question encore fragile et malheureusement de plus en plus, parce que l’extrême-droite parle de plus en plus fort, et elle est soutenue par des structures institutionnelles. À l’inverse, beaucoup luttent pour exhumer l’Histoire, pour retrouver la mémoire, parce que sinon on a l’impression que la dictature a été une période très « Pourquoi pas ». Franco il faisait de bonnes choses, non ?
L.D. : Pourquoi ouvrir ce spectacle avec ce drapeau qui reste à l’avant-scène dans une très longue séquence ?
A.M. : Quim voulait d’abord exposer le drapeau pendant une demi-heure en silence mais c’était de la folie ! On a réduit à quinze minutes, ce qui est déjà long, c’est vrai. Après dix représentations à Barcelone et les réactions de beaucoup de spectateurs, on a ajouté une phrase dans le spectacle. La marionnette de Franco, Franquito, dit en riant qu’on peut bien supporter le drapeau quinze minutes quand on a supporté le franquisme quarante ans. D’autant que chez nous, le drapeau espagnol est vraiment connecté à cette époque, à la dictature, à l’extrême-droite, contrairement à d’autres pays où ce symbole est davantage pluriel. Cela commence peut-être à changer un peu, grâce au football par exemple…Après, quand on a retravaillé le spectacle au Centre Dramatique National d’Orléans, on a pensé qu’en France nous devions contextualiser davantage, et nous avons mis un texte qui explique que ce drapeau est devenu anticonstitutionnel. Il est interdit de l’utiliser dans des espaces publics, dans les mairies, dans les manifestations. Mais sur scène, dans un but artistique, c’est en revanche légal. Cependant, on peut trouver ces drapeaux partout, les acheter sur internet, dans des magasins. On nous a fabriqué ce drapeau exprès, sans que personne ne se soucie de son usage. On aurait pu faire une manifestation fasciste extraordinaire avec ce drapeau-là.
L.D. : Comment avez-vous eu l’idée de la petite marionnette de Franco ?
A.M. : Quim dit que c’est parce que Franco était lui-même une marionnette ! Au-delà de cette formule, nous utilisons peu de métaphores dans notre travail, nous allons directement au but. Dans Rebota rebota, y en tu cara explota, des femmes sont assassinées : un homme jette des couteaux. On parle du franquisme, on convoque donc Franco. Ensuite, à partir de ces éléments, nous commençons à étoffer. On s’est ici souvenu de ce ventriloque que je fais dans Rebota rebota. Et on s’est dit pourquoi ne pas essayer de faire vraiment un numéro de ventriloquie avec une marionnette ? On a cherché et on a créé Franquito, avec lequel je dialogue. Mais je parle avec lui alors que je suis tâchée de sang. Cela crée une image qui peut évoquer les personnes assassinées. Après nous ferons peut-être une petite marionnette de la personne symbolisant l’extrême-droite dans les pays où nous jouerons – nous le faisons déjà en France avec celle de Marine Le Pen. Car nous parlons de l’Espagne mais on élargit à notre société européenne, blanche, bien pensante.
L.D. : Ce qu’il y a au coeur du spectacle, c’est aussi la notion d’obéissance. Parce que vous dites, il y a les fascistes, mais pour qu’il y ait les fascistes, il faut qu’il y ait des gens qui obéissent.
A.M. : Oui, la phrase qui nous guide dans tout le spectacle, c’est qu’il est beaucoup plus facile d’être fasciste. Parce qu’il n’y a rien à choisir. Et c’est vraiment beaucoup plus pratique de vivre comme ça : tu te prends pas la tête, tu obéis et la faute est toujours celle des autres, cela ne dépend pas de ta propre conscience. Alors, dire cela, évidemment, c’est pousser un peu à l’extrême. Mais oui, c’est beaucoup plus simple de ne pas penser, d’arrêter de se questionner pour éviter que notre tête n’explose. C’est l’obéissance par commodité, parce que je vis beaucoup plus tranquille si je ne dois rien faire. C’est comme ce qui est loin, ce qui arrive maintenant à Gaza par exemple. La réaction peut être : laisse tomber, parce que c’est pas mon histoire. Mais au bout d’un moment, quelqu’un vient et frappe à ta porte, et tu appelles au secours. Les fascistes sont là, tout près. Ils commencent à agir contre des gens comme nous, déjà à notre niveau. Cela arrive dans notre entourage. Alors oui, l’obéissance, il faut l’éradiquer. En même temps, tu ne peux pas changer le monde entier. Chacun doit agir à sa mesure. C’est pour cela que dans la dernière partie du spectacle, quand je sors en aigle, c’est cela qui est convoqué. Tu vas à quelle église ? À quelle école tu envoies tes enfants ? En école privée ou publique ? Ton médecin, c’est public ou privé ? Tu acceptes de l’argent pour faire quoi ? Tout cela, ce sont de petites actions, des symboles, des attitudes, des décisions qui peuvent mener à une société qui, peu à peu, dérive vers l’extrême-droite. Et ce spectacle-là nous a coûté beaucoup par rapport à Hostiando a M et Rebota, car dans ces derniers, nous étions du côté des victimes : victimes de la violence policière dans les manifestations, victime des violences machistes. Ici nous avons dû nous déplacer. Sommes-nous du côté des victimes, ou de celui des privilégiés qui peuvent agir pour changer cela ? Nous sommes des blancs européens, de classe moyenne, avec un entourage, une famille, des amis, une maison, la culture. Alors, où est-on dans le fascisme quotidien ? On est du côté des victimes, ou de celui des « acteurs » ? On a décidé de se mettre à la place des « acteurs », et cela a été beaucoup plus difficile d’agir sur scène.
L.D. : Pour vous, en tant qu’interprète, est-ce également plus difficile ?
A.M. : Oui bien sûr, parce que changer de point de vue m’a mise en difficulté. Le point de vue de la victime, ce n’est pas toujours facile bien sûr, mais en même temps c’est très clair et ce qui est très clair est beaucoup plus commode. Là nous devions nous analyser un peu nous-mêmes, et cela sans en faire un spectacle militant. Parce qu’on est au théâtre, pas dans une conférence. Un endroit où l’on peut faire des choses extrêmes comme casser une machine à laver...
L.D. : Votre forme est du côté de la performance. Est ce que vous aviez envie d’aller chercher le spectateur justement à cet endroit pas très clair ?
A.M. : On essaie de secouer le spectateur d’une façon ou d’une autre. Cette fois, c’est plus agressif, je crois, parce je crie beaucoup, tout le temps, je casse une machine… Mais on utilise ce type de langage, on travaille depuis cet endroit depuis le début. Je suis habituée à faire ce genre de chose sur scène et Quim vient aussi de la performance. On utilise toujours ce type de communication directe avec le spectateur. Mais il y a aussi des scènes très théâtrales comme la scène avec Franquito, ou le personnage de l’Aigle. C’est un mélange, cela relève aussi parfois du cabaret, qui permet de tout dire d’une façon directe et puissante.
L.D. : Il est beaucoup question du pouvoir dans cette pièce. Et, pour vous, art et politique sont très liés. Pensez-vous que le théâtre a encore un pouvoir ?
A.M. : Pour nous, bien sûr, le théâtre a encore un pouvoir. Sinon, que fait-on là ? La scène est un endroit d’où l’on peut dire les choses. C’est comme une plateforme, on peut l’utiliser pour beaucoup de raisons, pour se manifester politiquement et publiquement, pour amuser les gens aussi. Nous avons choisi la part plus engagée politiquement, parce que nous sommes comme ça dans la vie. On habite, avec 23 personnes, dans un lieu qu’on récupère pour un projet culturel complètement fou… Cela dit, je ne prétends pas qu’il faut toujours être aussi cohérent ! Mais pour nous, oui, il y a là un pouvoir. Même si, en même temps, on croit que le théâtre est une chose un peu ancienne. Parce que c’est quand même bizarre, aujourd’hui, de faire un spectacle pour 50 ou 100 personnes qui applaudissent alors qu’avec un message sur X ou Instagram, des milliers de personnes vous disent « I like it ». C’est donc quelque chose qui devient un peu comme une folie, comme Fitzcarraldo. Mais moi j’ai été à cet endroit toute ma vie, alors je trouve cela vital. C’est un lieu où l’on peut vraiment partager des émotions, toucher et changer les gens. Ce n’est pas du tout une métaphore. Avec Rebota, avec Hostiando a M, avec Patatas fritas falsas*, on a partagé des choses qui ont modifié le point de vue de Quim, le mien, et celui des spectateurs venus voir le spectacle. Et ça c’est une forme de pouvoir, bien entendu. Le pouvoir de faire penser, bouger un peu les autres, même en faisant un spectacle joli, uniquement esthétique. La beauté est aussi une arme. Il peut y avoir des gens qui voient une œuvre très esthétique qui les transforme. Je pense aux spectacles de La Veronal par exemple, avec leurs chorégraphies magnifiques. Il ne faut pas être seulement « politique » pour changer les gens. C’est simplifier beaucoup que de penser cela. On peut voir une chose très belle, qui modifie quelque chose en soi. C’est sûr. Nous on croit cela, nous croyons que la scène a un pouvoir, les artistes, les théâtres et le public aussi, totalement.
- Personnage d’un film éponyme de Werner Herzog (1982) qui rêve de construire le plus grand opéra du monde au cœur de l’Amazonie. Il échoue mais transforme son navire en théâtre en accueillant chanteurs et musiciens pour un spectacle unique au cœur de la forêt. .