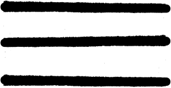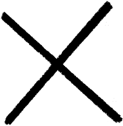Victor Roussel : Qu’est-ce qui vous a convaincue de créer pour les salles de classe ?
Betty Tchomanga : Le spectacle est d’abord issu d’une commande que m’a passée Maïté Rivière, alors directrice du Quartz à Brest, théâtre auquel j’étais associée. Elle m’a proposé de réfléchir à une forme qui s’adresse à la jeunesse, alors je me suis posé la question de ce que j’avais envie de transmettre à des collégien·nes et lycée·nes. Je venais de partir au Bénin car je m’intéressais au vaudou pour ma précédente création, Leçons de ténèbres, et j’avais l’impression d’y avoir découvert une autre façon de parler de la traite et de l’esclavage. Je me suis aussi rendu compte à quel point on avait une image ignorante du vaudou, une image issue de la pensée coloniale. En discutant de mon travail avec des enseignantes, j’ai constaté que ces thèmes faisaient écho au programme d’Histoire de 4e et de 3e. Je me suis dit que mon rôle en tant qu’artiste était peut-être de proposer, dans une salle de classe, une vision qui décale le programme scolaire, qui questionne la façon dont l’Histoire est transmise et dont est enseignée la colonisation, dont on ne parle plus aujourd’hui comme on en parlait il y a 60 ans. Et puis j’ai le goût d’aller jouer hors des théâtres ; depuis mon solo Mascarades j’aime naviguer entre les espaces.
V.R. : Chaque portrait est d’abord le fruit d’une rencontre…
B.T. : Le processus de travail s’est affiné avec le temps puisque les portraits se sont créés successivement. Mais, dès le départ, je voulais commencer les répétitions par plusieurs jours d’entretiens. Même si je connaissais déjà les quatre interprètes, j’avais d’abord envie d’être dans une posture d’écoute, de me laisser guider par leur histoire, par leur manière de se raconter et d’entrer dans ce travail. Je pouvais ensuite rebondir, réfléchir à ce qui m’interpellait dans leurs récits, et dégager un axe de travail pour chaque portrait. Un procédé d’écriture a émergé avec le portrait d’Emma : j’ai écrit pour chacun·e un texte à la première personne du singulier, chaque phrase commençant par « je suis », en partant des informations présentes sur la carte d’identité, ce document administratif qui circonscrit qui nous sommes, pour ensuite raconter nos lignées, nos ancestralités, pour voyager dans le temps et l’espace et traverser les dates qui ont fait l’histoire personnelle et la grande Histoire. Selon les portraits, ce procédé a pu faire émerger différentes tonalités ou registres, d’une adresse directe vers des formes plus poétiques.
V.R. : Comment s’est écrite la danse à partir de ces portraits ?
B.T.: Emma, Folly, Dalila et Mulunesh ont des histoires de corps très différentes, et c’est la première fois que je n’ai pas écrit la danse en amont, sur mon propre corps. J’ai vraiment essayé d’aller chercher les danses qui les constituent, en leur demandant par exemple quelle était la danse de leur enfance, leur danse d’aujourd’hui, la danse qu’iels détestent, celle qu’iels connaissent pas coeur ou celle qu’iels ignorent. Folly, je l’avais rencontré au Bénin, je connaissais son rapport au vaudou, à la danse et à la musique de cette culture. À partir de cette matière, j’ai voulu dissocier la danse traditionnelle de la musique, pour voir ce que les gestes racontent et creusent par eux-mêmes, débarrassés de tout regard folklorique. Avec Dalila, est venue assez vite l’image d’une danse guerrière, d’« empowerment », inspirée des danses de groupes de sororité des universités américaines, et qui faisait pour moi écho à son histoire. C’est ce qui a donné la première danse qui apparaît que j’appelle la « danse du voile ». Ce sont autant les gestes que la manipulation du tissu qui font la chorégraphie. Pour Emma, j’ai écrit une danse inaugurale que j’ai appelée le « maître fou », sur une musique de Max Roach, comme un chef d’orchestre qui va trop vite, jusqu’à la pantomime et le burlesque. Enfin, avec Mulunesh, nous sommes parties du krump, qu’elle pratique aujourd’hui, et d’eskista, une danse traditionnelle éthiopienne qui est restée gravée dans sa mémoire alors que, dans son parcours d’adoption, elle avait fini par oublier sa langue d’origine. J’ai trouvé très fort que la danse soit restée alors que la langue a disparu. Cette danse éthiopienne est très axée sur des mouvements des épaules et de la tête, des mouvements que j’ai étirés et répétés pour que d’autres choses apparaissent depuis la tradition.
V.R. : Quel rôle ont joué les costumes dans la création ?
B.T. : Les portraits se sont construits grâce aux costumes qui, dans mes créations, jouent toujours un rôle important. Ces costumes ont une fonction de protagonistes c’est-à-dire qu’ils participent au récit au même titre que la danse, la musique ou le texte. Le tissu-monde dont est vêtue Emma évoque ainsi l’histoire ethnocentrique, celle des explorateurs, d’un Occident qui a du mal à se décentrer. Il s’agissait de questionner la carte comme représentation du monde affichée dans toutes les salles de classe. Le costume de Folly nous fait changer de perspective, car il s’inspire de tentures qui racontent l’histoire du royaume du Dahomey, il dessine une autre topographie. Dans le portrait de Dalila ce sont les voiles qui renvoient bien sûr à la culture musulmane et à la religion mais qui deviennent également des drapeaux, voire des peaux… Ils agissent comme des couches qui révèlent, transforment et font apparaître une complexité à travers laquelle ce qu’on regarde n’est jamais figé.
Enfin, la collerette blanche que porte Mulunesh est un symbole fort qui renvoie d’abord à la représentation des personnages importants dans la peinture classique. C’est une manière de se réapproprier l’histoire et de proposer d’autres histoires comme importantes !
V.R. : Comment avez-vous rassemblé ces quatre portraits en un spectacle unique ?
B.T. : En quittant les salles de classe pour la scène, une dramaturgie s’est écrite et elle correspond finalement à la chronologie de la création des portraits. Les interprètes ne se connaissaient pas toustes, Emma et Mulunesh se sont notamment rencontrées en découvrant leurs soli respectifs ! Au début des répétitions, nous avons essayé d’entremêler les différents récits pour composer une écriture chorale, mais cela ne fonctionnait pas. Les interprètes dansent finalement leur solo les un·es après les autres et se passent le relai. Il a fallu écrire ces moments de passage, puis un épilogue qui les réunit et ramasse le geste. Et c’est parce que chacun·e a pu prendre sa place qu’on peut finir par l’apparition d’une fresque, d’un monument chargé des histoires qui ont été racontées et traversées. La dernière image est celle d’un portrait de groupe qui fait face à l’assemblée de spectateurices. Par ailleurs, je n’ai pas voulu surligner les résonances des quatre portraits, je préférais que les échos apparaissent dans le regard des spectateurices. Qu’au fur et à mesure de ce voyage, comme en miroir, on puisse se raconter sa propre identité, son histoire, ses héritages, ce qu’on sait de nous et ce qu’on ignore encore. La puissance singulière de chaque interprète, leur pluralité, permet aussi de sortir collectivement d’un rapport trop binaire à la violence de l’Histoire. La voix et le chant ont joué un grand rôle à cet égard.