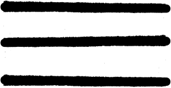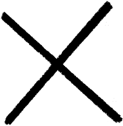Victor Roussel : Vos spectacles sont des formes hybrides, mélangeant musique, vidéo, robotique… Dans Haribo Kimchi, vous ajoutez un nouveau medium : la cuisine. Quelle a été la place de la nourriture dans l’écriture ?
Jaha Koo : Depuis longtemps, je réfléchis à la nourriture comme moyen d’expression artistique. Avec la vidéo je sollicite le regard, et l’ouïe avec la musique. Je voulais aussi m’adresser aux autres sens des spectateurs, à leur odorat et à leur goût. Dès mon spectacle Cuckoo, j’interagissais avec un cuiseur à riz, et le temps de la représentation était celui de la cuisson. Mais je n’avais pas encore trouvé une façon de construire toute une dramaturgie autour de la nourriture, en permettant au public d’expérimenter collectivement les dimensions esthétiques et politiques de la cuisine. Haribo Kimchi s’est concrétisé quand j’ai eu l’idée de la scénographie, inspirée des pojangmachas, des petits restaurants mobiles qui se déplacent dans les rues de Séoul. Ils n’ont pas d’adresse, ils apparaissent dès que le soleil se couche, accueillent au milieu de la nuit ceux qui veulent continuer à boire et à manger, puis disparaissent le matin comme des fantômes. Les pojangmachas sont des petites tentes montées sur roue, faciles à déplacer, faisant de la nourriture une migration continue. Cela me parlait de ma propre situation en Europe. Je suis arrivé en 2011 et, depuis quinze ans, ma vie et mon sentiment d’appartenance culturelle ont changé. J’ai en partie adopté un mode de vie européen, et la nourriture me paraît un medium puissant pour parler de l’entre-deux identitaire, des différences et des multitudes entre cultures. Toutefois, contrairement à mes précédents spectacles entièrement autobiographiques, je voulais avec Haribo Kimchi laisser une plus grande place à la fiction, créer davantage de distance entre la représentation et mon histoire. Ce sont des questions que je continue de creuser : comment puis-je occuper la scène tout en me mettant le plus en retrait possible ? Comment puis-je laisser la musique, la vidéo et la cuisine parler d’elles-mêmes ? Comment permettre aux spectateurs de faire leur propre trajet ? Le spectacle est ainsi constitué de quatre plats, comme autant de chapitres, un menu qui évoque plusieurs histoires autour la nourriture, en lien avec des problématiques sociales, avec la nostalgie, avec le traumatisme et enfin avec l’intimité.
V. R. : À partir de votre histoire, Haribo Kimchi s’intéresse donc à la nourriture comme vecteur d’appartenance, et notamment à son rôle dans les diasporas ?
J. K. : Quand je suis arrivé en Europe, la nourriture kimchi* était peu connue, mais cela a depuis beaucoup changé : à ma grande surprise, le kimchi est devenu très familier. Grâce à mes spectacles, j’ai beaucoup voyagé et j’ai pu manger dans plusieurs restaurants sud-coréens. À Rome par exemple, j’ai mangé du kimchi délicieux, qui m’a d’abord paru étrange avant que je me rende compte qu’il avait en fait le même goût que celui préparé par ma grand-mère. J’ai réalisé que les Coréens qui tenaient ce restaurant avaient émigré en Italie dans les années 1980 et n’avaient pas changé la recette depuis leur arrivée, alors qu’en Corée les goûts ont changé, les plats ont évolué. J’étais donc à l’étranger, et je faisais l’expérience d’un musée du goût. Ce fut un point de départ pour le spectacle. Mon regard s’est élargi sur la signification de la culture kimchi. Selon les pays, les communautés diasporiques sud-coréennes ont développé leurs propres recettes, en s’adaptant aux ingrédients locaux. En Lettonie le kimchi de carotte a été inventé, il n’existe pas en Corée et pourtant s’est répandu jusqu’à être considéré comme typiquement coréen. En Corée, nous utilisons de la poudre de chili importée, alors qu’au Brésil les recettes sont préparées avec du chili frais, cela change tout, les couleurs, la saveur, l’odeur… Quand j’ai rencontré les diasporas de ces pays je me suis rendu compte que les traits de leurs visages étaient différents, qu’ils ne parlaient plus coréen, que leur mode de vie, naturellement, s’était hybridé. La seule chose qui demeurait était le rôle familial joué par la nourriture. Le kimchi me permet donc de parler d’identité, de climat, de géographie, de géopolitique, de tradition et de diaspora.
- Le kimchi est un mets traditionnel coréen composé de piments et de légumes lacto-fermentés.
V. R. : Les histoires diasporiques relèvent de l’intime, de trajectoires personnelles et familiales. La nourriture kimchi joue-t-elle aussi un rôle politique en Corée du Sud ?
J. K. : Tout à fait. Le gouvernement sud-coréen a cherché à exporter la gastronomie, en commençant notamment par ouvrir des restaurants dans des grandes villes comme New-York, puis youtube et tik-tok ont pris le relai. Comme avec le cinéma ou la musique K-pop, le gouvernement a fait de la culture un outil diplomatique, une arme stratégique très capitaliste, pour vendre la Corée comme une marque à l’international. Je suis toujours surpris car cette vision très impérialiste de la culture était jusqu’ici plutôt le fait de la Corée du Nord, qui est experte en matière de propagande, notamment en ouvrant des restaurants à l’étranger et en y donnant des spectacles.
V. R. : Sur scène, on découvre un nouveau robot, qui vient rejoindre le cuiseur de Cuckoo et la grenouille origami de The History of Korean Western Theatre. Quelles relations continuez-vous d’explorer avec la technologie ?
J. K. : J’accueille en effet dans Haribo Kimchi un nouveau performer robot qui prend la forme d’une anguille. Dans ma pratique, concevoir des robots reste un work in progress. Dans Cuckoo, le cuiseur à riz pouvait parler et chanter mais restait immobile. Dans The History of Korean Western Theatre, la grenouille origami pouvait se déplacer. J’avais envie d’aller encore plus loin, en continuant d’imaginer des biorobots plutôt que des robots anthropomorphiques à l’allure ultra-masculine. L’anguille est un robot à la fois fluide et solide : au début de leur vie, les anguilles ressemblent à une sorte de gelée translucide, puis s’allongent et prennent leur couleur adulte. Quand elles changent de forme, leur identité et leur vie se décident, elles font une expérience intime de la migration. J’ai voulu que l’anguille robot soit encore à moitié transparente, dans un entre-deux, à l’image de ma propre identité diasporique. Mais je crois que tout le monde, à un moment de sa vie, peut ressentir un état diasporique, en allant vivre dans une autre ville, en vieillissant, en traversant des évènements psychologiquement marquants. J’ai donc conçu l’anguille – son design, son attitude, sa manière de chanter – comme un symbole, une métaphore, mais j’ai mis du temps à vraiment croire en elle. Car j’ai besoin de croire que les robots ont leur propre existence sur scène, qu’ils sont vraiment des performers. Aujourd’hui, j’ai l’intuition que les spectateurs acceptent complètement sa présence.
V. R. : Au fil des années, les robots et les intelligences artificielles occupent une place de plus en plus importante dans nos vies quotidiennes. Comment cela résonne-t-il avec votre travail ?
J. K. : Au début de ma carrière artistique, j’abordais surtout la technologie dans la société sud-coréenne. Cette société est puissamment patriarcale, avec une structure hiérarchique très rigide, héritée du confucianisme. Je trouvais que le robot de Cuckoo était une bonne métaphore pour montrer la pression que ressentent les Coréens, et notamment les plus jeunes. Pour imaginer comment faire bouger cette organisation sociale, je voulais faire en sorte de déhiérarchiser les différents éléments présents sur scène : la vidéo, la musique, les robots, moi-même… Mais aujourd’hui, ce n’est plus étonnant de voir un robot, nous avons construit des rapports quotidiens et efficaces avec la technologie, et depuis peu avec l’intelligence artificielle. Cela soulève des questions éthiques et politiques que je me pose forcément, au-delà de la métaphore. La société coréenne est d’ailleurs très contradictoire : d’un côté elle est enfermée dans ses traditions, de l’autre elle court après toutes les innovations high-tech, dont l’utilisation est marquée par une culture très masculine. Ces contradictions entraînent des problèmes importants, à l’image de la crise actuelle concernant la création de contenus pornographiques avec des deep-fakes.