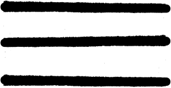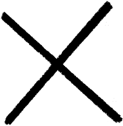Victor Roussel : Pouvez-vous revenir sur la genèse du spectacle et de son écriture ?
Kenza Berrada : Mon point de départ était l’envie de traduire en arabe Blackbird, une pièce de David Harrower. Je voulais dire dans cette langue le long monologue d’une jeune femme qui retrouve son agresseur. Dès le début, la question du consentement était donc centrale, de même que celle des frontières, notamment des frontières du corps. Je me suis ensuite éloignée de ce texte pour mener une enquête au Maroc en rencontrant des femmes dans leur trentaine, de différentes origines et classes sociales, arabophones et francophones, et en les interrogeant sur le consentement. À travers elles je m’intéressais aussi à l’histoire des générations précédentes, de nos grands-mères mariées à l’adolescence. Parmi ces témoignages, une femme que j’ai renommée Houria m’a raconté sa première histoire d’amour avec un homme de 37 ans alors qu’elle n’en avait que 19. Au fur et à mesure de nos conversations, je comprenais que la question du consentement était complexe pour elle, à cause d’un évènement qui lui était arrivé plus jeune et qu’elle taisait. Il a fallu qu’on se voit une dizaine de fois pour qu’elle me fasse la confession d’un abus sexuel qu’elle avait subi enfant. Cette révélation a tout changé. Pour écrire le spectacle, je me suis mis à faire des aller-retours entre la voix de Houria sur une cassette audio et mes tentatives de réponse, comme pour trouver la meilleure manière d’écouter cette confession. J’utilise le mot confession car c’est toujours sacré lorsque quelqu’un vous raconte son histoire. Pour autant, je ne voulais pas simplement retranscrire ces interviews et les restituer de manière frontale. Je voulais une multitude de voix autour d’elle. Il y a un océan de femmes qui ont vécu la même chose mais à qui on n’a jamais tendu un micro, notamment au Maroc où il y a très peu d’espaces de parole ou de justice pour les personnes abusées sexuellement. C’est aussi pour cette raison que j’ai créé un spectacle au format léger, je ne sais pas si c’est un acte militant mais je voulais pouvoir me déplacer facilement et le jouer dans le plus d’endroits possibles au Maroc, dans une galerie d’art, un cirque, un hammam…
V. R. : Comment avez-vous articulé cette histoire intime avec le mythe du Boujloud ?
K. B. : Dans le spectacle, le Boujloud est finalement arrivé assez tard. Au départ je voulais appeler le spectacle Atteinte à la pudeur car c’est la terminologie utilisée au Maroc pour parler du viol. La figure du Boujloud est liée à un rite ancestral marocain. Le lendemain de l’Aïd, un homme se recouvre de peaux de mouton et court après les femmes dans la rue en frappant parfois leurs fesses avec des branchages. Un anthropologue explique que cet homme est puni et transformé en animal pour avoir abusé d’une femme dans un lieu sacré. Quand j’ai recroisé l’image du Boujloud lors d’un festival, j’ai été saisie par la puissance de cette réminiscence mythologique. C’est un monstre à la fois craint et adoré, très ambivalent. Pourtant, ce rite se perd, il n’est pas enseigné dans les manuels scolaires, et il est très difficile de trouver des archives vidéo. Alors que le Boujloud dit beaucoup de la psyché marocaine. Beaucoup d’enfants se souviennent ainsi de ce monstre comme d’un traumatisme après l’avoir croisé dans une rue, d’emblée vécue comme un espace hostile. C’est aussi ce que j’essaye de raconter dans la pièce, c’est la façon dont le souvenir remonte à la surface de la peau, du corps, et la manière dont le refoulé resurgit dans une société. Si Boujloud n’est pas célébré de la même manière selon les régions, le point commun des célébrations se trouve dans la mascarade, puisque cette figure est aussi entourée d’autres personnages : la femme, le juge, l’esclave, tous joués par des hommes. Dans le Rif, il surgit d’une grotte et la musique joue un rôle très important. Les musiciens jouent une dizaine d’heures d’affilées, jusqu’à la transe, et le son de leurs flûtes nous a beaucoup servi pour le spectacle. Cette musique lancinante, cette répétition, a aussi fait écho à l’histoire d’Houria qui a essayé plusieurs fois de parler de son abus mais qui n’a jamais été écoutée. Je la voyais comme perdue dans ses tentatives de dire, et je voulais explorer les effets de ces redites sur le corps.
V. R. : Le corps et la danse ont d’ailleurs un rôle très important dans le spectacle…
K. B. : La place du corps était fondamentale. Qu’est-ce qu’un corps emmagasine comme souvenirs d’une agression ? Comment l’écoute d’un récit de violence peut réactiver des choses qu’on a soi-même vécu ? Pour écrire les parties chorégraphiques, j’ai commencé par m’inspirer des danseuses houaryates, qui dansent avec leurs cheveux, mêlant la musique à leurs mouvements dans une forme de transe très impressionnante. J’ai aussi travaillé à partir de mouvements d’épaules qu’on peut retrouver dans le Haut Atlas où les hommes et les femmes se font face. Mais je ne voulais pas être dans le folklore, j’ai cherché à tordre les stéréotypes qu’on pourrait avoir de la danse orientale, notamment en accentuant le côté répétitif. Au tout début, j’avais une approche plutôt naturaliste, j’essayais d’incarner les personnages en étant le plus proche possible de la réalité. À un moment donné, j’ai trouvé cela trop sage, je voulais aller plus loin dans ce que mon corps pouvait transmettre, et une fois que j’ai trouvé le mythe de Boujloud, j’ai essayé de trouver en moi une forme d’animalité. Lorsque j’interprète la narratrice, j’ai ainsi cherché quelque chose entre l’humain et le bestial. Par exemple, je ne suis jamais sur l’entièreté de mes pieds mais toujours en demi-pointe, en instabilité. J’ai travaillé avec Elsa Wolliaston, une grande danseuse contemporaine, aujourd’hui âgée de 75 ans, qui est née au Kenya puis a dansé à New York et donne encore des cours de danses africaines.
V. R. : La scénographie semble fragmenter le rituel pour composer un autre territoire, aux frontières plus incertaines. Comment avez-vous travaillé cet espace intermédiaire ?
K. B. : J’ai été marqué par le film Under the Skin de Jonathan Glazer dans lequel Scarlett Johansson joue une extraterrestre qui attire des hommes et les plonge dans une grande mare noire. J’ai gardé en tête la sensation d’engloutissement et cet entre-deux, l’acceptation de ne pas tout comprendre. L’entre-deux permet ainsi l’ambivalence : je suis une femme qui prend la peau d’un homme, d’un agresseur, je suis aussi une adulte qui redevient une enfant de sept ans, tantôt dans une adresse frontale au public, tantôt enfermée dans les personnages que je joue. Cela a d’ailleurs été compliqué de trouver la place que je voulais adopter vis-à-vis des femmes qui m’ont raconté leur histoire, de trouver le bon langage, l’endroit que je voulais occuper formellement. Est-ce que je suis actrice, autrice, danseuse ? J’ai travaillé avec des metteurs en scène très naturalistes, j’ai été nourrie au théâtre classique dès le collège au Maroc, et c’est en arrivant en France que j’ai découvert la performance et ses possibilités pluridisciplinaires. Entre le Maroc et la France, entre deux langues, où devais-je situer mon premier geste artistique ? J’ai été envahie par ces questionnements avant d’assumer de raconter cette histoire à ma manière, en utilisant la première personne du singulier, en endossant le rôle de narratrice et en m’inspirant des conteurs de la place Jemaa El-Fna à Marrakech, entourés par un cercle d’auditeurs. Le spectacle reconvoque ces formes traditionnelles du récit pour transmettre d’autres histoires, des histoires passées sous silence, et pour donner la parole aux victimes d’abus sexuels.
V. R. : Toutes les matières présentes sur scène vous servent-elles également à vous réapproprier un héritage traditionnel ?
K. B. : Les matières que je manipule au plateau sont autant d’éléments disparates que je voulais relier ensemble, tout en permettant aux spectateurices de les interpréter différemment selon leur culture et leur histoire. Lorsque je me badigeonne d’argile, cela évoque immédiatement le hammam pour un public marocain, mais cela convoque d’autres images en France. Et quand l’argile sèche sur ma peau et se fendille, c’est comme une métaphore du spectacle, évoquant les récits de violence qui s’immiscent à travers les interstices. J’aime aussi l’idée d’un volcan qui se craquelle. Le spectacle a une dimension physique, géologique. Tactile aussi, avec les peaux de moutons qui recouvrent le sol. Je voulais trouver le plus de formes possibles en partant de l’évocation de ce sacrifice animal, qui se fait l’écho des vies sacrifiées de nombreuses femmes. Les peaux de moutons sont à la fois réconfortantes et dégoûtantes, elles incarnent tout le fantasme de l’intérieur qui se révèle, des tripes, du sang. Et quand je couds ces peaux entre elles, comme j’ai vu coudre ma grand-mère toute sa vie, j’assemble les différents imaginaires culturels et traditionnels qui m’habitent. Ce geste évoque aussi la question de la virginité et de l’hymen recousu.
V. R. : Pourquoi vous est-il apparu nécessaire d’incarner la parole de la victime mais aussi de l’agresseur ? Comment avez-vous approché l’incarnation de ces deux paroles ?
K. B. : Houria et moi, nous avons le même âge, et nous sommes devenues amies. Je l’ai beaucoup observée, sa manière de respirer, de marcher et de s’habiller, de se raser ou de ne pas se raser, sa façon de tenir ses jambes ou de bouger ses mains. J’ai écouté les enregistrements de sa voix, et j’ai repris peu à peu son phrasé. C’est une personne d’une grande douceur alors qu’elle est très militante dans la vie. Elle est double, et les personnages qui m’intéressent sont toujours doubles. Elle fait des choses extraordinaires au Maroc pour les personnes exclues de la société, elle se bat au quotidien. Son engagement et sa confession m’obligent à un geste de pudeur, malgré l’abrupt du spectacle : elle m’a transmis une parole et je la transmets à mon tour. Je parle de pudeur car j’ai voulu être très attentive à celleux qui recevront le spectacle et qui ont vécu une agression. Je voulais créer le bon espace de représentation, un espace qui n’existe que très rarement aujourd’hui pour accueillir la parole des personnes violées et incestées. Lorsque j’ai échangé avec un agresseur – une des personnes apparaissant dans La Liberté, un documentaire de Guillaume Massart – j’ai constaté qu’il avait du recul, qu’il avait réfléchi à ce qu’il avait fait. Il avait pris le temps de mettre des mots sur son acte. Même un bourreau peut réfléchir à ce qu’il a fait, on ne lui pardonne pas pour autant. Houria, elle, n’a jamais eu accès à cette parole, et je crois que cela peut aider à se reconstruire. Neige Sinno en parle très bien dans Triste tigre.