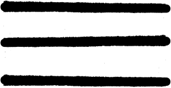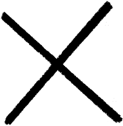Victor Roussel : Comment s’inscrit Ex Machina dans la série de vos solo performance et à la suite de Longwy-Texas ?
Carole Thibaut : J’ai créé Fantaisies - L’idéal féminin n’est plus ce qu’il était en 2009 puis Longwy-Texas en 2016, et je me suis demandé comment je pouvais relier ces deux formes. Avec Fantaisies je cherchais un rapport performatif, le spectacle était composé de brèves, de séquences avec des représentations scéniques très différentes, outrancières, avec comme question principale : une fois enlevées toutes les couches de l’idéal féminin, qu’est-ce qu’il reste de mon identité ? Dans Longwy-Texas, le texte était premier, je porte une histoire autofictionnelle très écrite. J’entre en scène, habillée en noir et derrière un pupitre, le spectacle prend l’apparence d’une conférence et, même si ce récit me bouscule toujours, j’occupe une place que je maîtrise. Pour interroger l’articulation du genre et du pouvoir, je savais que je devais m’attaquer à cette représentation de moi-même, que je devais remettre en jeu ma présence sur scène, physiquement et pas seulement dans les mots, en expérimentant plusieurs transformations et en traversant plusieurs formes de représentations théâtrales, du stand-up à la performance en passant par du playback et des prothèses mammaires protubérantes. Ce caractère hybride suit pourtant une ligne dramaturgique très tenue, jusqu’à la fin du spectacle où, comme une dernière tentative de mise à nu, j’abandonne tous les costumes, me présentant seulement comme un corps, un corps qui est ce qu’il est.
V. R. : Pourquoi, en partant d’une écriture de soi, autobiographique, avez-vous ressenti la nécessité de manier autant de théâtralités différentes ?
C. T. : Je pense que nous sommes multiples, et le fait de se cantonner à une seule identité, en tant que personne ou en tant qu’artiste, c’est déjà s’enfermer dans le mensonge d’une représentation sociale. Je ne veux pas être une artiste qui trouve une recette et l’applique à chaque spectacle. Je crois que le théâtre est une matière qui n’arrête pas d’évoluer, on se transforme constamment et je trouve très important de continuer à expérimenter sur scène les transformations que j’ai vécues en tant que femme et en tant qu’artiste.
V. R. : Pourquoi avez-vous ressenti la nécessité d’interroger frontalement la construction genrée du pouvoir ?
C. T. : J’ai ressenti le besoin de créer Ex Machina après avoir été prise d’un vertige : comment, avec mon histoire, avec le père que j’ai eu, je peux me retrouver à la tête du CDN de Montluçon, à un poste où j’exerce à mon tour la violence du pouvoir ? En tant que directrice d’une institution, je suis moi-même forcément en train d’exercer de la violence parce que j’ai une fonction dominante sur certaines personnes. Même involontairement je participe à un système violent, hiérarchique. Et si je n’exerce pas cette violence, je parais moins légitime, je me le vois parfois reprocher ! Je me suis aussi rendu compte que les femmes qui deviennent directrice d’une institution cessent d’être actrices, comme si jouer et diriger impliquaient deux représentations inconciliables du féminin. La question du genre et du pouvoir, c’est une question de représentation, c’est pour cela que je dois être sur scène. J’accueille le public dans la posture de la directrice, avant de rapidement me retrouver vulnérable, en peignoir.
V. R. : Ce spectacle a-t-il déplacé intimement et politiquement votre rapport au pouvoir ?
C. T. : Mon corps, à partir du moment où je suis directrice d’un théâtre et que j’ai plus de 50 ans, n’a plus lieu d’être sur un plateau. C’est trop fragile d’être directrice et de se mettre autant en jeu sur scène. Les hommes directeurs, eux, peuvent se le permettre sans problème. Bien sûr, les postes de pouvoir entravent aussi la liberté de celleux qui l’exercent, on doit se plier à la fonction. Et quand on est une femme, il faut encore plus se surveiller, faire sans cesse attention à la manière dont on se présente et dont on parle. J’ai ainsi vu des femmes de ma génération, quand elles arrivent au pouvoir, s’extraire du camp des dominées, se désolidariser de la violence subie et affirmer qu’elles n’avaient jamais été victimes du patriarcat. Lorsque je suis devenue directrice du CDN de Montluçon, j’ai tenu un carnet de bord pour noter toutes les pensées, les contradictions, pour ne pas oublier ma trajectoire. Puis j’ai senti la nécessité de traverser cette complexité dans mon corps même en créant Ex Machina, et cela a été très violent. Heureusement que j’ai eu autour de moi une équipe bienveillante, car j’étais vraiment à poil. Il était vital pour moi de continuer à jouer et à écrire car je voulais être traversée par un autre langage que celui du pouvoir. Le rôle de metteur en scène est le plus facile à concilier avec le poste de directeur car il est aussi un endroit de pouvoir sur les autres. Quand on écrit, au contraire, on est seul face à soi-même, face à ses gouffres, en train de gratouiller dans sa chambre en fumant clope sur clope. Et être actrice, c’est un endroit d’insouciance, c’est se laisser traverser par des choses qu’on ne maitrise pas. Oui, rester actrice, c’est pour moi une question de survie artistique et morale.
V. R. : Rester autrice et actrice, c’est aussi pour vous l’occasion de continuer à raconter d’autres récits du pouvoir, des récits où les femmes ne sont pas invisibilisées ?
C. T. : Dans la fiction comme dans l’Histoire, tout récit commence par la disparition d’une femme. Hélène Cixous disait bien que lorsqu’elle se rendait au théâtre, elle avait l’impression d’aller à son enterrement. Et quand une femme refuse de disparaître et occupe un rôle politique fort, alors on la prive de sexualité, comme pour la punir. Pendant la création d’Ex Machina, les écrits de l’historienne Éliane Viennot m’ont beaucoup accompagnée. Elle a mené un grand travail de recherche sur les femmes et le pouvoir en France, elle raconte des reines qui ont été totalement effacées et qui pourtant ont régné plus de dix ans. Caliban et la sorcière, de Silvia Fedirici, est une autre lecture vertigineuse, liant le génocide des femmes et le capitalisme naissant, racontant comment des clercs ont créé l’université et exclu les femmes du savoir en organisant une cabale qui aboutit finalement à la chasse aux sorcières.
V. R. : Dans Ex Machina, vous incarnez d’ailleurs une chevalière qui prend les armes. Même dans un spectacle aussi politique et frontal, la forme du conte reste une matrice pour votre écriture ?
C. T. : Le conte est récurrent dans mon travail, mais je m’en rends compte souvent a posteriori. La forme du conte est fondatrice ; elle préexiste à l’écriture. C’est un récit d’apparence très simple mais, dans de nombreuses cultures, c’est une manière de transmettre d’une génération à l’autre tous les codes, les mystères de la vie, les interdits, ouvrant autant d’imaginaires symboliques, métaphoriques, politiques… Sans avoir besoin de grands mots ou de grandes explications, car le conte s’éprouve d’abord dans la façon dont il est transmis. Le conte me permet de déplacer mon jeu, mon énonciation, même lorsque je parle de ma vie et de mes expériences. Car pour moi, l’endroit du théâtre c’est la fable.
Au coeur du conte, il y a aussi la question de la violence…
Ça parcourt toute mon oeuvre. Avec le couteau le pain, une des premières pièces que j’ai écrite et dans laquelle je me reconnais vraiment, raconte l’histoire d’une gamine confrontée à la violence du père, et j’avais imaginé une première fin où la gamine devenait mutique avant d’être mariée à un jeune homme. Le dramaturge Armando Llamas, dont j’étais très proche à l’époque, m’a alors dit : « Pourquoi c’est toujours les mêmes qui trinquent à la fin ? Il vaudrait mieux qu’elle tue tout le monde ! » C’est dingue, j’avais en effet reproduit un schéma de victimisation ! Finalement, je n’ai pas choisi qu’elle tue tout le monde mais elle part tout de même avec un couteau à la main. La violence est toujours une question prégnante. À partir du moment où on vit dans un monde violent, dans un système familial patriarcal, on ne peut pas y échapper. Comment on réagit face à ça ? Est-ce qu’on prend les armes, est-ce qu’on se soulève ? Est-ce qu’on essaye de faire bouger les choses de l’intérieur ou est-ce qu’on s’extrait de tout ? Ex machina raconte exactement ça et, en écrivant le spectacle, je ne savais pas non plus comment terminer. J’ai mis un temps fou à trouver cette fin, pour que la violence sous-jacente ne triomphe pas de manière aveugle. Alors je termine par appeler à une forme d’union, de relation entre les êtres qui permettrait de faire surgir la puissance nécessaire pour mettre à bas un système de domination. Je continue à y croire même si, avec le temps, l’apprentissage que nous faisons de l’obéissance me désespère.
V. R. : C’est pour interroger cette obéissance que vous malmenez un peu le public ?
C. T. : Tout à fait. Je trouve trop facile de s’imaginer seulement du côté des victimes, trop facile d’écrire une pièce ou d’aller au théâtre pour s’identifier seulement au personnage que je joue. Je raconte que j’ai été agressée sexuellement, que j’ai subi du harcèlement et des tentatives de viol, je partage tous les doutes qui m’habitent encore. Mais nous vivons dans un système où même une victime peut parfois faire preuve de violence. Sur l’échelle de la domination, nos positions sont mouvantes. Je suis une féministe engagée, mais le plateau pour moi n’est pas un exercice militant car il est le lieu de la complexité et des zones obscures. C’est pour cette raison que je met en scène une séquence où j’exerce de la violence sur quelqu’un, séquence durant laquelle les spectateurices sont amenés à questionner leur propre relation à l’obéissance tacite. N’importe quelle personne sur scène exerce un pouvoir. C’est elle qui fait le récit, c’est elle le «dictateur», au sens premier de celui qui dicte.
En cela, le théâtre garde un pouvoir symbolique très puissant, et si les artistes dérangent toujours, s’est qu’iels peuvent, à travers les récits qu’iels portent, imposer leur représentation du réel.