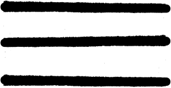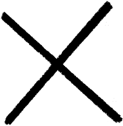Laure Dautzenberg : Comment est né ce projet ?
Maurin Ollès : J’ai découvert il y a quelques années L’inconnu du lac d’Alain Guiraudie et j’ai été fasciné. Je me suis alors plongé dans les autres films de ce cinéaste et ma fascination a redoublé. J’ai appris qu’il avait écrit un roman, Rabalaïre. En le lisant, très vite, au bout de 300-400 pages – c’est un roman énorme, de mille pages -, j’ai pensé qu’il serait formidable de l’adapter au théâtre. J’avais la sensation que Guiraudie fait en littérature ce qu’il ne peut pas faire au cinéma, c’est-à-dire être dans la tête du personnage. Dans ses premiers films, il utilise parfois une voix off, mais celle-ci peut s’épuiser assez rapidement. Je me disais que le théâtre pouvait permettre d’explorer cela. Ensuite je suis sensible à son univers. Il y a sa poésie, ses récits qui parlent d’amour, de relations humaines, mais aussi l’humour qu’il déploie, avec des situations très drôles. Ce que je trouve beau chez lui, c’est que ses personnages, qui sont souvent ses alter egos, sont toujours dans la réflexion, se posent des questions sans arrêt. Enfin c’est quelqu’un qui a une grande fantaisie, il n’hésite pas à aller vers le poétique, le fantastique... Il va surtout à fond dans la fiction, il décide de mettre des meurtres, un polar, il s’amuse beaucoup et cela me plaît. Et parallèlement, il y avait le désir de retrouver Pierre Maillet avec lequel j’avais déjà travaillé sur Letzlove - Portrait(s) Foucault. J’avais envie que ce soit moi, cette fois, qui lui propose un projet.
L.D. : Comment avez-vous rencontré Pierre Maillet et pourquoi ce texte vous a semblé immédiatement lui convenir ?
M.O. : J’ai rencontré Pierre quand j’étais à l’école de la Comédie de Saint-Etienne alors que j’étais en troisième année et lui parrain de la première année. Il a en quelque sorte accompagné ma sortie : il m’a pris sur Letzlove - Portrait(s) Foucault et nous nous sommes très vite croisés de nouveau parce que j’ai joué dans Un beau ténébreux, mis en scène par Matthieu Cruciani, pièce dans laquelle il était aussi. On s’est donc beaucoup côtoyés et on a appris à se connaître. Cela m’a donné envie de prolonger l’aventure. Lui proposer l’adaptation de Rabalaïre me paraissait une bonne idée : Pierre est très attaché au cinéma ; il a adapté au théâtre Pasolini, Fassbinder, des cinéastes qui sont aussi des inspirations directes de Guiraudie. Par ailleurs, il vient de Narbonne, ce n’est pas tout à fait l’Aveyron de Guiraudie, mais on n’est pas si loin !
L.D. : Pierre Maillet interprète Jacques, le personnage principal, mais c’est vous qui interprétez tous les autres rôles. Pourquoi avoir fait ce choix ?
M.O. : Un peu à la manière de Portrait(s) Foucault, j’avais envie d’une petite forme, je voulais retrouver notre duo. Ce désir de n’être que deux au plateau a guidé l’adaptation. Nous avons cherché comment ramasser les scènes, faire exister un repas où il y a beaucoup de gens, fondre deux gendarmes en un... Par ailleurs, le fait que je joue tous les autres personnages masculins, qu’ils aient le même visage, permet d’appuyer la poursuite de la rêverie de Jacques : tous ces hommes peuvent être potentiellement fantasmés par lui. On est vraiment dans la tête du personnage. De ce point de vue, il a fallu trouver l’adresse à adopter. Au début, je disais à Pierre de ne pas regarder le public, mais cela ne marchait pas. Nous avons donc cherché une manière d’adresser le regard sans appuyer, sans casser le quatrième mur. On ne « dénonce » pas le théâtre. C’est vraiment « vous êtes dans ma tête ».
L.D. : D’où est venu ce titre ?
M.O. : Le narrateur dit souvent dans le roman : et j’en suis là de mes réflexions, et j’en suis là de mes rêveries... Je trouvais ça beau parce que c’est vraiment Guiraudie. Quand on écoute ses interviews, il parle, il dérive, il fait tout le temps des digressions, il se contredit parfois : il dit oui, voilà ceci, cela... Ah et en même temps, c’est vrai que je pourrais dire l’inverse ! Et puis, la rêverie, la fantaisie, les songes, tout cela me plaisait bien. Parce qu’il est évidemment beaucoup question d’imagination.
L.D. : Alain Guiraudie a lui-même adapté son livre avec Miséricorde...
M.O. : Oui, le film est sorti le lendemain de notre première à Colmar, ce qui était un hasard complet. Quand nous avons commencé à travailler, Guiraudie avait déjà adapté une partie de Rabalaïre avec Viens je t’emmène, mais il s’agissait d’une toute autre histoire que celle qui nous intéressait. Là, nous nous penchons tous les deux sur le moment où il est question de Gogueluz, du curé... Le détail amusant est que je l’ai appris en étant contacté pour passer le casting ! Lui s’est davantage permis de réécrire que nous. Il a modifié les âges, certains des rapports, et en même temps, il y a évidemment beaucoup de résonances, au-delà même de la stricte adaptation. Par exemple, je me souviens que dans une scène de nuit, on s’était dit que cela serait bien de rajouter un peu de texte, que cela dure un peu plus longtemps, pour qu’on ait l’impression que la nuit se passe. On a juste ajouté « Ah, on ira cueillir des champignons », parce qu’on était nourri de Guiraudie. C’est donc drôle de voir que dans Miséricorde, il y a aussi des histoires de cueillette de champignons ! Nous lui avons envoyé l’adaptation. Je ne suis pas sûr qu’il l’ait lu, pas comme quelque chose de désinvolte, plutôt comme une façon de nous laisser faire notre travail.
L.D. : Le cinéma est présent dans votre mise en scène : le spectacle s’ouvre sur un extrait du Roi de l’évasion doublé au plateau par Pierre Maillet, et il y a dans la scénographie une dimension de petite fabrique du récit...
M.O. : Comme Guiraudie est cinéaste, je me suis très vite dit qu’on allait essayer de convoquer les matériaux, le champ lexical du cinéma. Au départ, nous avions imaginé être dans un laboratoire de création, avec des storyboard de cinéma, une maquette de théâtre, afin de créer une histoire parallèle, une mise en abîme... Mais cela alourdissait le récit et ces éléments sont restés davantage comme des clins d’œil qui permettent d’explorer la manière de raconter l’histoire. Par exemple, dans l’extrait du Roi de l’évasion que l’on projette, le motif du vélo faisait écho à notre adaptation et nous avions d’abord pensé jouer la scène. Puis a surgi l’idée de la projection et du doublage, ce qui était une manière d’installer le cinéma, au même titre que ces choses entreposées un peu partout sur le plateau et qui peuvent être sollicitées pour le récit.
L.D. : Vous projetez même un film au beau milieu du spectacle. Pourquoi avoir choisi de lui donner cette place ?
M.O. : D’abord, j’avais envie d’essayer de faire ça au théâtre, de mettre un film au milieu d’une pièce et de voir ce que cela produit. Ce qui se passe à Gogueluz est sur le plateau de théâtre, et ce qui se passe dans le Lot, chez l’amant de Jacques, est projeté sur un écran. Dans la dramaturgie, je trouvais cela bien, cela permettait de faire césure entre les deux parties : la première est dans le registre de la comédie, la dernière relève plutôt du polar et du fantastique. Entre les deux il y a ce film. Comme chez Guiraudie, chez lequel on retrouve les thèmes, les motifs, les lieux, mais avec des saveurs, des genres différents. On passe ainsi d’une tonalité à une autre, d’un genre à un autre, d’une forme à une autre.
L.D. : Dans l’œuvre de Guiraudie, il y a une vraie dimension sociale, mais qui n’est pas du tout affirmée comme telle. La compagnie que vous avez fondée, La Crapule, travaille elle aussi beaucoup sur des problématiques sociales...
M.O. : Bien sûr l’aspect social de son cinéma me touche. Il y a des points communs dans nos parcours. Guiraudie a été inscrit au Parti communiste pendant longtemps ; j’ai été membre de la Jeunesse communiste, également pendant longtemps. Dans le livre, il est fait mention de langues régionales ; mon père est professeur de provençal. Dans les personnages que l’on a décidé de montrer il y a le curé, son amant, des gendarmes, mais il y a aussi Rémi qui est un gars avec lequel Jacques travaillait dans une usine. C’était important de garder cela. Mais là où Guiraudie m’inspire beaucoup, c’est que par la fiction, par les histoires qu’il choisit de raconter, il parle de ces problématiques sociales sans que cela soit appuyé. On sent que c’est quelqu’un de curieux, qui aime regarder les gens et n’avance pas avec des certitudes. Guiraudie n’est jamais moralisateur. Et, à l’inverse, il ne cherche pas à déranger. Il prend simplement du plaisir à inventer des histoires, à mettre ses personnages dans des situations qui vont lui permettre de parler de relations humaines, de parler d’amour. Et de s’imaginer plein de trucs. Mes spectacles sont un peu plus frontaux dans le diagnostic politique. Et c’est pour ça que je regarde aussi attentivement comment il s’empare de ces sujets-là, sans en avoir l’air. Mais je crois que c’est parce qu’il est assez honnête en vérité. Il parle de ce qu’il connaît, de ce qu’il observe. C’est pour ça que quand moi je parle ensuite dans d’autres spectacles de l’autisme ou dans mon prochain spectacle de drogue et de politique publique, l’idée c’est que je sache aussi de quoi je parle pour savoir ce que j’ai envie de raconter.
L.D. : Il y a un moment de bascule avec une part violente, des meurtres. Comment avez-vous abordé cette partie-là ?
M.O. : C’était assez simple dans le sens où dans le texte, je trouve qu’il n’y a rien de choquant. Les situations que vit Jacques sont même assez drôles. Quand il dit après le meurtre, « Oh là là, c’est quand même beaucoup de soucis de toujours penser à tout, le moindre détail, ça pourrait me conduire à un surmenage, ça doit bien exister le burn out du criminel. », j’avais l’impression qu’il y avait de la matière à jeu. Il a tué deux personnes, et il continue de se poser des questions en profondeur. Qu’est ce que ça me fait ? C’était un accident, c’était pas un accident ? Je suis un meurtrier ? Dans cette partie, la frontière entre rêve et réalité devient de plus en plus poreuse. Pierre est torse nu, on sent qu’il y a quelque chose qui a vrillé. Il s’adresse beaucoup moins au public à ce moment-là. J’avais envie qu’on entre dans le tourbillon de ce qui se passe pour lui...