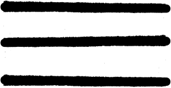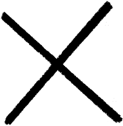Victor Roussel : Pourquoi avez-vous choisi, avec les autres membres du Collectif Marthe, de mettre le terme «famille» au pluriel dès le titre du spectacle ?
Aurélia Lüscher : Au tout début, puisque nous sommes un collectif, nous voulions nous questionner sur le fonctionnement des groupes, et le groupe ultime dont tout le monde fait l’expérience reste la famille, ou son absence. Dès le début, nous nous sommes rendues compte que nous avions toutes les quatre des familles très différentes, aucune ne se ressemble, alors que nous sommes relativement proches, nous faisons partie de la même génération. Il nous a paru très clair que nous ne pouvions pas parler de la famille au singulier, et nous souhaitions aussi proposer plusieurs perspectives possibles, ouvrir les champs de l’imaginaire autour de cette notion.
V.R. : Vos spectacles articulent recherches intimes et réflexions politiques : comment avez-vous abordé cette écriture dans Vaisseau familles ?
A.L. : Cet aller-retour entre nos intimités et l’Histoire s’est fait assez vite en entrant dans le sujet, puis nous avons mis l’accent sur l’Histoire, avant de réintégrer nos intimités comme fil directeur de nos trajectoires dans la dramaturgie. Nous avons passé beaucoup de temps le nez dans les livres, comme à notre habitude. Pour chacune d’entre nous, ce n’était pas la même implication émotionnelle de se pencher sur sa famille... C’est donc assez tard que nous avons ramené une matière plus intime au sein du spectacle, plutôt au moment où nous sommes vraiment passées au plateau. Une partie du squelette dramaturgique s’est construit à la table, à partir d’une chronologie historique qu’on voulait traverser et des perspectives imaginaires qu’on voulait explorer. L’intime s’est greffé à ça, plutôt comme un liant. Mais c’est vrai que nous choisissons toujours de nous intéresser à un sujet parce que nous avons l’intuition qu’il va nous bouleverser et changer notre vision des choses, que la création du spectacle va avoir un impact concret sur nos vies quotidiennes. Et ce spectacle nous a effectivement, enfin je l’espère, aidé à mettre des mots sur la manière dont nous vivons nos familles et sur les collectifs qu’on aimerait fabriquer.
V.R. : Au cours de vos lectures, quelles découvertes vous ont le plus marquées ?
A.L. : Déjà, nous nous sommes rendues compte avec un peu d’effroi que, dans la frise historique de l’humanité, l’existence de la famille nucléaire blanche comme modèle absolu occupe une place minuscule et très récente ! Ce modèle émerge véritablement au 19e siècle et triomphe dans les années 50 aux Etats-Unis et il a tenté de coloniser le monde entier. Il y a toujours eu d’autres manières de faire famille que ce modèle, mais ils ont été niés, invisibilisés. Des chercheureuses ont décrit sept structures de parentés différentes. J’ai par exemple adoré regarder du côté des maisonnées. Dans Quotidien politique, Geneviève Pruvost étudie le mouvement des féministes de la subsistance et se rapporte aux fonctionnements des sociétés paysannes avant l’arrivée du capitalisme et de la société de consommation : les gens se réunissaient dans des foyers d’entraide, sans avoir forcément de liens de sang, souvent des travailleurs et travailleuses qui élevaient les enfants en commun, travaillaient la terre ensemble, comme le fonctionnement d’un village au sein d’une grande maison. Ce fût une révélation pour nous de voir l’écart entre ces maisonnées et la famille nucléaire contemporaine, que Foucault décrit très bien, en parlant de ce tournant fou où la société, jusqu’à l’architecture des appartements, s’est articulée autour de cette vision restreinte du foyer.
V.R. : Votre Vaisseau familles fait-il également de la place aux relations amicales ?
A.L. : Le rôle des amitiés dans nos vies a pris beaucoup de place dans les recherches que j’ai menées pour le spectacle. Un désir démesuré d’amitié d’Hélène Giannecchini m’a beaucoup accompagnée : les relations amicales sont reléguées en second plan par la société alors qu’elles sont pour beaucoup aussi importantes que les relations familiales. L’amitié est peu reconnue par la loi, il est par exemple compliqué de léguer des biens à des amis… On parle beaucoup de familles choisies aujourd’hui. Ça m’a ouvert des portes de me dire que des ami·es peuvent choisir d’élever un même enfant ensemble, de mettre le soin de cet enfant au centre du projet. Je trouve ça très soulageant comme idée d’avoir ce relai-là possible.
V.R. : Le théâtre, en jouant avec les rôles, vous a-t-il également permis de questionner une vision genrée de la parentalité́ ?
A.L. : Très clairement. Une scène, en particulier, rend évidente l’absurdité de cette distribution genrée des rôles. Pour convoquer nos enfances dans les années 1990, nous avons regardé nos VHS familiales, et nous nous sommes rendues compte que c’étaient tout le temps les pères qui filmaient. S’amuser avec ces films permet de voir à quel point les pères mettent en scène leur famille, en dirigeant la caméra.
V.R. : En repensant nos façons de faire famille, quelle place votre spectacle fait-il aux enfants ?
A.L. : Notre première expérience de la famille, c’est d’abord notre propre enfance. Beaucoup d’enfants parcourent donc le spectacle, et certains sont en révolte, réclament des droits. Aujourd’hui, les enfants ont un statut proche de l’animal au sein de la famille. Suivant les époques, ils n’ont pas leur mot à dire et ne sont pas écoutés, pas même par la justice dans le cas de violences intrafamiliales. On peut facilement être dans un rapport d’autorité vis-à-vis des enfants, pas dans un rapport de cohabitation, déhiérarchisé.
V.R. : Vous convoquez sur scène, et interprétez, des oiseaux, des termites… Pourquoi avoir fait cette place aux animaux dans l’écriture du spectacle ?
A.L. : Quand on s’est rendues compte qu’on était en train d’étudier nos familles comme des structures sociales vues de l’extérieur, un peu comme des chercheuses qui observeraient un biotope, on s’est mis à lire beaucoup de livres d’éthologie. Et le documentaire animalier est devenue un grand allié pour l’écriture du spectacle, pour étudier les fonctionnements de notre propre espèce. Il y a par exemple ce livre génial de Vinciane Despret, La danse du cratérope écaillé, où elle étudie ces oiseaux qui vivent dans le désert du Néguev et qui ont une manière très particulière de vivre ensemble : ils ne savent jamais qui est le géniteur, à qui appartient l’œuf, donc la couvade se fait collectivement puis chacun s’occupe de l’oisillon comme si c’était le sien. Mais Vinciane Despret étudie aussi les gens qui observent ces oiseaux, les ornithologues qui viennent dans le Néguev depuis des années pour observer le cratérope, et elle montre à quel point le regard porté sur les animaux est très subjectif et change selon les évolutions de notre société. Dans Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions ?, Vinciane Despret parle aussi d’animaux qui ont été tout d’abord décrit comme fidèles, comme pour donner raison à la morale humaine, puis au fur et à mesure de nos avancées sociétales, on s’est rendu compte que pas du tout, ces animaux étaient polygames… Nous projetons nos propres fonctionnements sur les autres espèces. Alors, à l’inverse, nous avons cherché à projeter le fonctionnement des animaux sur nos façons de faire famille. L’une d’entre nous a ainsi commencé à parler de sa famille nombreuse comme d’une colonie d’insectes, réunie autour d’une reine…
V.R. : Faire de la famille une matière vivante, cela passe aussi par le travail de corps et de costumes ?
A.L. : Pour déconstruire l’aspect parfois immuable de la famille, pour parler des transformations de cette notion, il nous fallait expérimenter ces métamorphoses de l’intérieur, développer des figures moins humaines, incarner des figures plus multiples, hybrides, animales. Nous avons donc demandé à des collaboratrices de nous aider à nous transformer : Léa Gadbois-Lamer sur le costume, Cécile Laloy sur le corps et Cécile Kretschmar sur les postiches et les silhouettes. Nous avons voulu ainsi travailler la porosité entre les époques, les genres, les espèces, les personnages, pour brouiller les frontières, superposer les identités… Le temps d’une scène, nous sommes à la fois trois oiseaux et trois copines en train de discuter sur un lit.
V.R. : Les animaux ne servent donc pas seulement de métaphore, ils deviennent aussi source d’inspiration. Est-ce à dire que nous pouvons étendre nos familles au vivant ?
A.L. : J’ai un chien, Mousse, j’en parle dans le spectacle, je voulais même qu’il soit avec nous au plateau mais je l’ai en garde partagé, donc c’était difficile. Mais évidemment il fallait qu’il soit là, d’une manière ou d’une autre. Les animaux sont des membres de nos familles, on s’inquiète pour eux, il faut les faire garder, c’est une relation quotidienne. Dans Attachements, enquête sur nos liens au-delà de l’humain, Charles Stépanoff parle de tous les attachements interespèces formés au cours de notre Histoire. On a par exemple longtemps vécu avec les bêtes sous le même toit, on faisait maison avec elles, et c’est assez tard qu’on a sorti les animaux des foyers. Le mouvement hygiéniste, la classification des espèces, ont tracé des frontières radicales avec le vivant. La philosophe Donna Haraway nous invite plutôt à considérer comme espèces compagnes les bactéries qui peuplent nos corps, le riz qui a évolué avec nous et qu’on a élevé pour qu’il convienne à notre alimentation….
V.R. : Si l’on suit Donna Haraway, l’attachement familial ne serait pas seulement une affaire d’héritage génétique, mais aussi du microbiote que nous finissons par partager avec les êtres qui nous sont proches. Faire famille autrement, c’est aussi faire un peu de science-fiction…
A.L. : Le spectacle évolue en effet de cette manière et, là encore, Donna Haraway nous inspire beaucoup, puisqu’elle fabrique sa pensée en faisant des fabulations spéculatives. Par l’imaginaire, nous pouvons faire naître d’autres narrations, inventer de nouvelles façons d’être en lien. Nous avons aussi beaucoup été inspirées par les mouvements des femmes queer autochtones qui repensent la place des enfants, de la terre, du soin dans leurs quotidiens. Le spectacle part de faits historiques et se déréalise de plus en plus, nous cherchons des endroits où nous pouvons faire des expérimentations et réinvestir le mot « famille » de plein de récits possibles et à venir.